i Attention : ne pas confondre activité lucrative et but lucratif !
Les activités lucratives d’une association sont ses activités économiques et commerciales.
Le but lucratif signifie qu’après la dissolution d’une association son actif net subsistant peut être partagé entre les membres.
Toute association à but non lucratif peut exercer des activités économiques à partir du moment où son objet est désintéressé. La seule interdiction faite à cette association est de distribuer ses bénéfices aux associés.
Lorsqu’une association veut exercer une activité lucrative, elle doit impérativement la faire figurer dans ses statuts.
Il existe trois cas de figure et chacun d’eux induit des conséquences différentes sur la fiscalité de l’association :
- Les actes de commerce ayant un caractère occasionnel et accessoire à l’activité principale sont des actes civil indissociables du but non lucratif poursuivi par l’association (organisation d’un bal, d’une kermesse, vente diverses au cours des manifestations, etc.) Cette activité économique accessoire est exonérée des impôts commerciaux si elle ne dépasse pas 60000 . par an de chiffre d’affaires pour les seules activités lucratives,
- Les actes de commerce ayant un caractère habituel se voient appliquer certaines règles du droit commercial. Si l’activité commerciale n’est plus accessoire et qu’elle prime sur l’objet statutaire de l’association, celle-ci devient commerçante. Les actes de commerce concernés sont énumérés à l’article L110-1 du Code de commerce,
- L’objet même de l’association est une activité commerciale avec intention spéculative et recherche de profit. L’association a la qualité de commerçant et, par conséquent, est soumis à certaines obligations en matière de fiscalité, de comptabilité, de concurrence, etc.

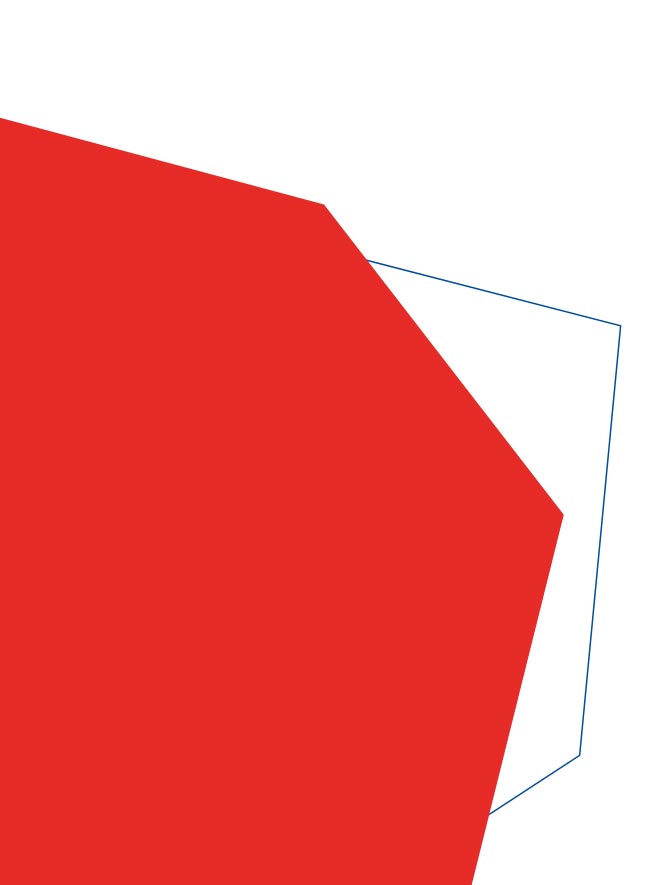

 Adhérer
Adhérer
