Les démarches d’installation
Une fois le bail signé et les clés en poche, il faut encore contacter le fournisseur d’électricité (EDF ou autre) et la compagnie ou régie chargée de la gestion de l’eau pour mettre les compteurs au nom de l’association.
En ce qui concerne l’électricité, vérifiez que la puissance du compteur est suffisante pour l’utilisation que vous voulez en faire. Les conseillers de votre fournisseur sont là pour vous aider : en listant vos équipements, ils pourront déterminer la puissance nécessaire. Il faut ensuite penser à la communication : combien de prises de téléphone ? Où ? Faut-il en installer de nouvelles ?
Les tarifs d’abonnement sont plus chers pour une activité associative que pour un particulier. Il peut être tentant de préférer mettre la ligne au nom de l’un des membres. Cependant, cela peut être source de difficultés si la personne s’en va, où s’il y a défaut de paiement d’un côté ou de l’autre.
Si ce local devient le siège de l’association, il vous faudra en faire la déclaration, en respectant les modalités inscrites dans vos statuts. Même si les statuts ne disent rien, le changement de siège social fait l’objet d’une déclaration en préfecture signée par le président et un membre du bureau, accompagnée, s’il y a lieu, du procès-verbal de la décision de changement par l’assemblée générale (le conseil d’administration ou le bureau) et d’un exemplaire de la modification des statuts (vérifiez les formalités auprès de votre préfecture compétente). Il faudra en outre renouveler ou modifier votre papier à en-tête, vos cartes de visite et votre tampon.
Enfin, tout bail exige du locataire de souscrire une police d’assurance afin de couvrir les éventuels dégâts ou incendies. Cette assurance devra en outre tenir compte de l’activité prévue dans les locaux ou d’une éventuelle période de travaux.
Si ceux-ci sont importants, négociez une participation sur devis de la part de votre propriétaire. Au cas où le montant est important vous pouvez, d’un point de vue comptable, les étaler sur plusieurs années par le biais d’amortissements. Il en va de même pour les aménagements ou le mobilier. En cas de travaux demandant des compétences particulières, il peut être préférable de faire appel à des professionnels qui offrent une garantie. Des travaux peuvent être considérés comme de l’investissement, auquel cas vous pouvez solliciter des aides auprès des collectivités locales ou des fondations. À vous de voir ce qui peut être pris en charge par les bénévoles et de les mobiliser en conséquence.
Enfin, si vous devez recevoir du public, pensez à la sécurité, certains aménagements sont à inclure dans le programme de travaux et des autorisations peuvent être nécessaires.
La sécurité des locaux
Le mieux est d’y penser dès le début. S’il s’agit d’un simple bureau réservé aux travailleurs, il n’y a pas lieu de prévoir de mesures particulières. Mais si l’on pense à des activités, il est bon de se renseigner au plus tôt sur la réglementation, assez complexe, de la sécurité des établissements recevant du public (ERP).
Sont considérés comme ERP » tous bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations payantes ou non » (article R-123-2 du Code de la construction et de l’habitation).
Les obligations auxquelles sont soumis les ERP en matière de sécurité incendie varient selon leur capacité d’accueil. Ils sont classés en 5 catégories et en 2 groupes. Le second comprend les établissements de 5ème catégorie, soit un effectif de moins de 200 personnes. Au delà et jusqu’à 300, il s’agit de la 4ème catégorie, jusqu’à 700 de la troisième catégorie. Les seuils suivants sont 1 500, avec la 2ème catégorie en dessous et la 1ère au delà.
Les ERP sont en outre classés par type, à savoir, pour ce qui concerne les activités habituelles des associations :
- L pour les salles de réunions, spectacles ou à usage multiples ;
- P pour les salles de dans ou de jeux ;
- T pour les salles d’expositions ;
- M pour les magasins ;
- W pour des bureaux.
La capacité d’accueil est calculée selon le rapport entre la surface disponible et l’usage prévu (personnes debout ou assises, etc.).
Les équipements obligatoires dépendent de l’activité et des sources de danger potentiel (stockage de produits, équipements électriques…). L’équipement sécurité-incendie demande au minimum un extincteur pour 200 à 300 m2 de surface, et par étage, une signalisation de sécurité sur les issues, un plan d’évacuation avec les consignes de sécurité par étage, les consignes de sécurité affichées dans toutes les salles où 5 personnes au moins peuvent être réunies, un registre de sécurité.
C’est la commission de sécurité (communale, arrondissement ou départementale) qui est chargée de vérifier le respect des normes dans les établissements. Elle est composée du préfet ou de son représentant, du maire ou d’un élu le représentant, de la Direction départementale de l’équipement (DDE), de la police ou de la gendarmerie, et d’un officier sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention. La visite de cette commission est indispensable pour l’ouverture des locaux.
Le mieux est de prendre contact avec ces services, par l’intermédiaire de la mairie, par exemple, et de les faire venir sur place afin de recueillir leur avis avant de s’engager dans des travaux ou même dans la location.
En savoir plus : protectionincendie.com
La solution de la mutualisation
Un local peut revenir cher. Il se peut aussi que l’usage prévu ne justifie pas une location à plein temps, ou que les activités soient compatibles avec celles d’une ou plusieurs autres associations voisines. On peut alors avoir recours à la mutualisation. Il s’agit de partager les frais et l’occupation de l’espace. Cela nécessite bien entendu de la concertation et du dialogue avec le propriétaire et avec les futurs partenaires.
Les modalités de partage et la répartition des charges et responsabilités doivent être très clairement définies, en faisant attention qu’aucune des structures concernées n’en tirent de profit direct, pour éviter une fiscalisation.
Quand les termes des accords sont bien établis, plusieurs solutions s’offrent à vous.
D’abord, la simple sous-location, qui demande l’accord exprès du propriétaire. Dans ce cas, une des associations est locataire officielle et établit une ou plusieurs conventions avec les associations utilisatrices, en précisant les heures et conditions de l’usage des locaux et le montant qui sera facturé (dont le calcul doit être justifié, surtout pas de forfait).
Une autre solution est de conclure le bail à plusieurs associations, avec une convention interne précisant la répartition des temps d’occupation, des responsabilités et des frais.
Enfin, on peut choisir de créer une structure dédiée, dont l’objet sera la location et la gestion des locaux. Là encore une convention précise liera l’association locataire et les utilisateurs.
La mutualisation, quand elle est bien pensée, présente d’autres avantages que de simples économies. Elle permet de tisser des relations régulières, de pouvoir confronter des modes de fonctionnement différents, de partager par simple fréquentation des informations, connaissances, ressources, et souvent, elles suscite l’émergence de projets communs et la conjonction d’actions compatibles ou complémentaires. Quoi qu’il en soit, elle permet pour le moins d’élargir le cercle de relations des adhérents.
Inauguration
Une fois les locaux prêts, toutes démarches effectuées, les aménagements terminés, il faut encore faire connaître votre localisation.
Le meilleur moyen, et le plus convivial reste d’organiser une inauguration. Vous en profiterez pour exposer de vive voix les objectifs et l’historique de votre association, et les raisons qui vous ont amenés à occuper ces locaux, ainsi que les perspectives que cela ouvre pour l’avenir de l’association. Vous pouvez l’annoncer par voie de presse, affichage, mais l’invitation personnalisée par courrier est indispensable.
Essayez de n’oublier personne lors de l’établissement de la liste des invités. Vos financeurs, bien sûr, vos adhérents, évidemment, mais aussi des élus communaux, départementaux ou régionaux, des journalistes, vos partenaires associatifs et professionnels, l’association de commerçants peut être aussi intéressée, votre propriétaire qui pourra constater les améliorations apportées au local, et vos voisins, qui se posent sans doute des questions devant les allées et venues de ces dernières semaines.
N’hésitez pas à élargir aux autres associations, même si elles vous sont étrangères, et à toute personne qui pourrait de près ou de loin être intéressée par vos activités. Prévoyez un délai raisonnable (une quinzaine de jours au moins) et un horaire qui puisse permettre à tout le monde de venir » faire un saut « , la fin d’après-midi étant souvent le plus pratique car cela ne bloque pas la soirée.
Toute animation est la bienvenue, de même qu’un apéritif et un buffet. Prenez des photos (avec l’accord des personnes) pour garder mémoire de cet événement. Ce sera l’occasion de distribuer vos nouvelles coordonnées, mais aussi de tester l’aménagement de l’espace, des voies de circulation et l’intérêt que vous suscitez.
Le point de vue de l’assureur
On l’a vu, ouvrir un local n’est pas toujours simple dès lors qu’on compte recevoir du public. En dehors de la police d’assurance obligatoire à toute occupation d’un local, il faut solliciter un rendez-vous avec votre assureur afin d’examiner avec lui tous les aspects de l’utilisation de ce local et de la protection des usagers et adhérents. Il saura en outre vous conseiller quant à la couverture des biens et aménagements, et aux règles de sécurité.

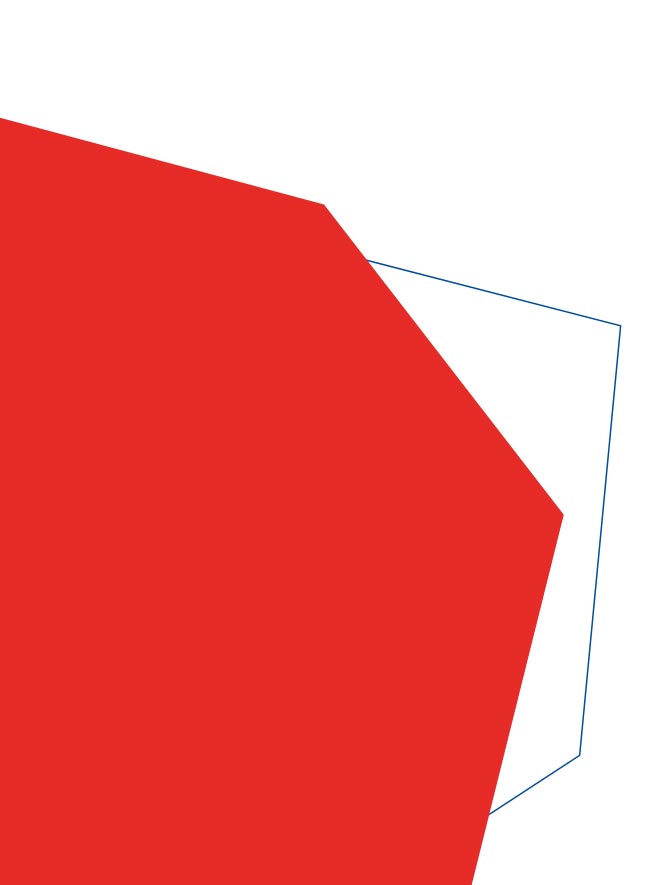

 Adhérer
Adhérer
