Les associations Loi 1901 n’ont aucune obligation de posséder une direction. Sauf dispositions statutaires contraires, le Conseil d’Administration ne peut agir en justice au nom de l’association.
Les associations d’Alsace-Moselle ont l’obligation de posséder une direction (article 26 du Code civil local) mais celle-ci peut n’être composée que d’un seul membre. La direction est le représentant judiciaire et extra-judiciaire de l’association.
Les Administrateurs
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont définis par les statuts.
En « Vieille France », ce sont les statuts qui définissent ces différents points. Ceux-ci peuvent également étendre les pouvoirs des administrateurs.
En droit d’Alsace-Moselle, ce sont les articles 26 à 31 qui règlent le mode d’élection, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs des administrateurs.
Compétences du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est une émanation de l’Assemblée Générale. C’est l’instance dirigeante de l’association.
Les administrateurs sont chargés d’assurer le bon fonctionnement de l’association et l’application des décisions prises en Assemblée Générale. Ils reçoivent une délégation de l’Assemblée Générale à ces fins.
Le Conseil d’administration prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l’association dans le cadre des statuts, de la mission confiée par l’Assemblée Générale et du budget.
Le Conseil d’Administration rend compte de sa gestion lors de l’Assemblée Générale suivante.
Qui peut siéger au Conseil d’Administration ?
- les membres de l’association
- les personnes extérieures à l’association à condition de bien délimiter le champ de leur intervention
- les mineurs si les statuts les y autorisent
- les personnes morales, mais elles doivent être représentées par une personne physique
- les étrangers
- les militaires, sauf dans des associations politiques, syndicales ou professionnelles
- les salariés, dans la limite du quart des membres du Conseil d’Administration. Ils ne peuvent siéger au bureau.

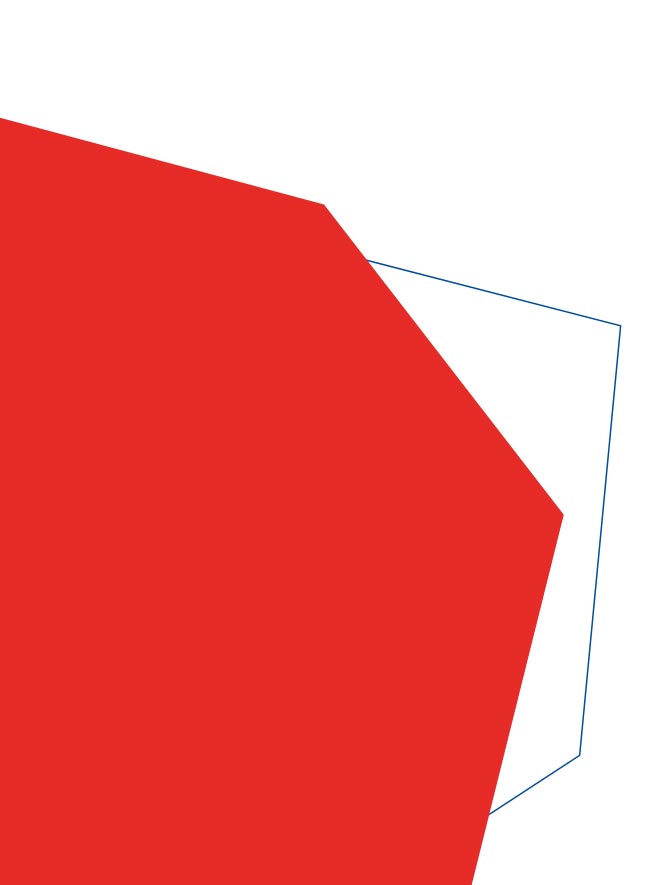

 Adhérer
Adhérer
